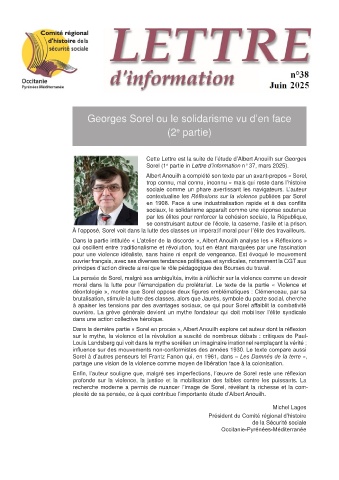Page 1 - lettre_crhssoccitanie_38h
P. 1
Georges Sorel ou le solidarisme vu d’en face
(2 partie)
e
Cette Lettre est la suite de l’étude d’Albert Anouilh sur Georges
Sorel (1 partie in Lettre d’information n° 37, mars 2025).
e
Albert Anouilh a complété son texte par un avant-propos « Sorel,
trop connu, mal connu, inconnu » mais qui reste dans l’histoire
sociale comme un phare avertissant les navigateurs. L’auteur
contextualise les Réflexions sur la violence publiées par Sorel
en 1908. Face à une industrialisation rapide et à des conflits
sociaux, le solidarisme apparaît comme une réponse soutenue
par les élites pour renforcer la cohésion sociale, la République,
se construisant autour de l’école, la caserne, l’asile et la prison.
À l’opposé, Sorel voit dans la lutte des classes un impératif moral pour l’élite des travailleurs.
Dans la partie intitulée « L’atelier de la discorde », Albert Anouilh analyse les « Réflexions »
qui oscillent entre traditionalisme et révolution, tout en étant marquées par une fascination
pour une violence idéaliste, sans haine ni esprit de vengeance. Est évoqué le mouvement
ouvrier français, avec ses diverses tendances politiques et syndicales, notamment la CGT aux
principes d’action directe ainsi que le rôle pédagogique des Bourses du travail.
La pensée de Sorel, malgré ses ambiguïtés, invite à réfléchir sur la violence comme un devoir
moral dans la lutte pour l’émancipation du prolétariat. Le texte de la partie « Violence et
déontologie », montre que Sorel oppose deux figures emblématiques : Clémenceau, par sa
brutalisation, stimule la lutte des classes, alors que Jaurès, symbole du pacte social, cherche
à apaiser les tensions par des avantages sociaux, ce qui pour Sorel affaiblit la combativité
ouvrière. La grève générale devient un mythe fondateur qui doit mobiliser l’élite syndicale
dans une action collective héroïque.
Dans la dernière partie « Sorel en procès », Albert Anouilh explore cet auteur dont la réflexion
sur le mythe, la violence et la révolution a suscité de nombreux débats : critiques de Paul-
Louis Landsberg qui voit dans le mythe sorélien un imaginaire irrationnel remplaçant la vérité ;
influence sur des mouvements non-conformistes des années 1930. Le texte compare aussi
Sorel à d’autres penseurs tel Frantz Fanon qui, en 1961, dans « Les Damnés de la terre »,
partage une vision de la violence comme moyen de libération face à la colonisation.
Enfin, l’auteur souligne que, malgré ses imperfections, l’œuvre de Sorel reste une réflexion
profonde sur la violence, la justice et la mobilisation des faibles contre les puissants. La
recherche moderne a permis de nuancer l’image de Sorel, révélant la richesse et la com-
plexité de sa pensée, ce à quoi contribue l’importante étude d’Albert Anouilh.
Michel Lages
Président du Comité régional d’histoire
de la Sécurité sociale
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée