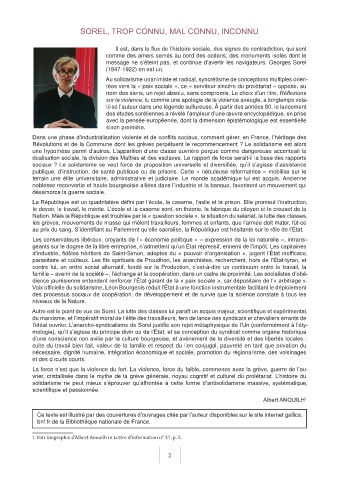Page 2 - lettre_crhssoccitanie_38h
P. 2
SOREL, TROP CONNU, MAL CONNU, INCONNU
Il est, dans le flux de l’histoire sociale, des signes de contradiction, qui sont
comme des amers semés au bord des océans; des monuments isolés dont le
message ne s’éteint pas, et continue d’avertir les navigateurs. Georges Sorel
(1847-1922) en est un.
Au solidarisme unanimiste et radical, syncrétisme de conceptions multiples orien-
tées vers la « paix sociale », ce « serviteur sincère du prolétariat » oppose, au
nom des siens, un rejet absolu, sans compromis. Le choix d’un titre, Réflexions
sur la violence, lu comme une apologie de la violence aveugle, a longtemps vola-
tilisé l’auteur dans une légende sulfureuse. À partir des années 80, le lancement
des études soréliennes a révélé l’ampleur d’une œuvre encyclopédique, en prise
avec la pensée européenne, dont la dimension épistémologique est essentielle
sinon première.
Dans une phase d’industrialisation violente et de conflits sociaux, comment gérer, en France, l’héritage des
Révolutions et de la Commune dont les grèves perpétuent le recommencement ? Le solidarisme est alors
une hypothèse parmi d’autres. L’apparition d’une classe ouvrière perçue comme dangereuse accentuait la
dualisation sociale, la division des Maîtres et des esclaves. Le rapport de force serait-il la base des rapports
sociaux ? Le solidarisme se veut force de proposition universelle et diversifiée, qu’il s’agisse d’assistance
publique, d’instruction, de santé publique ou de prisons. Cette « nébuleuse réformatrice » mobilise sur le
terrain une élite universitaire, administrative et judiciaire. Le monde académique lui est acquis. Ancienne
noblesse reconvertie et haute bourgeoisie alliées dans l’industrie et la banque, favorisent un mouvement qui
désamorce la guerre sociale.
La République est un quadrilatère défini par l’école, la caserne, l’asile et la prison. Elle promeut l’instruction,
le devoir, le travail, le mérite. L’école et la caserne sont, en théorie, la fabrique du citoyen et le creuset de la
Nation. Mais la République est troublée par la « question sociale », la situation du salariat, la lutte des classes,
les grèves, mouvements de masse qui mêlent travailleurs, femmes et enfants, que l’armée doit mater, fût-ce
au prix du sang. S’identifiant au Parlement qu’elle sacralise, la République est hésitante sur le rôle de l’État.
Les conservateurs libéraux, croyants de l’« économie politique » – expression de la loi naturelle –, intransi-
geants sur le dogme de la libre entreprise, n’admettent qu’un État répressif, ennemi de l’impôt. Les capitaines
d’industrie, fidèles héritiers de Saint-Simon, adeptes du « pouvoir d’organisation », jugent l’État inefficace,
parasitaire et coûteux. Les fils spirituels de Proudhon, les anarchistes, recherchent, hors de l’État-tyran, et
contre lui, un ordre social alternatif, fondé sur la Production, c’est-à-dire un continuum entre le travail, la
famille – avenir de la société –, l’échange et la coopération, dans un cadre de proximité. Les socialistes d’obé-
dience jaurésienne entendent renforcer l’État garant de la « paix sociale », car dépositaire de l’« arbitrage ».
Voix officielle du solidarisme, Léon Bourgeois réduit l’État à une fonction instrumentale facilitant le déploiement
des processus sociaux de coopération, de développement et de survie que la science constate à tous les
niveaux de la Nature.
Autre est le point de vue de Sorel. La lutte des classes lui paraît un acquis majeur, scientifique et expérimental,
du marxisme, et l’impératif moral de l’élite des travailleurs, fers de lance des syndicats et chevaliers errants de
l’idéal ouvrier. L’anarcho-syndicalisme de Sorel justifie son rejet métaphysique de l’Un (conformément à l’éty-
mologie), qu’il s’agisse du principe divin ou de l’État, et sa conception du syndicat comme organe historique
d’une conscience non avilie par la culture bourgeoise, et avènement de la diversité et des libertés locales :
culte du travail bien fait, valeur de la famille et respect du lien conjugal, pauvreté en tant que privation du
nécessaire, dignité humaine, intégration économique et sociale, promotion du régionalisme, des voisinages
et des circuits courts.
La force n’est que la violence du fort. La violence, force du faible, commence avec la grève, guerre de l’ou-
vrier, cristallisée dans le mythe de la grève générale, noyau cognitif et culturel du prolétariat. L’histoire du
solidarisme ne peut mieux s’éprouver qu’affrontée à cette forme d’antisolidarisme massive, systématique,
scientifique et passionnée.
Albert ANOUILH 1
Ce texte est illustré par des couvertures d’ouvrages cités par l’auteur disponibles sur le site internet gallica.
bnf.fr de la Bibliothèque nationale de France.
1. Voir biographie d’Albert Anouilh in Lettre d’information n° 37, p. 2.
2